Maladies et traitements
Qu’est-ce que le trouble dysphorique prémenstruel (TDPM) ?

Publié le
Par Cécile Fratellini
Temps de lecture estimé 4 minute(s)
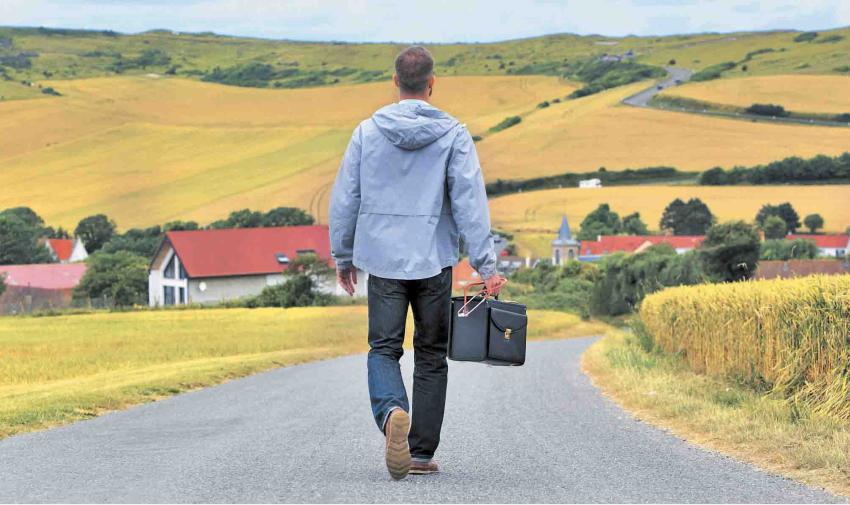
« Désolée, je ne prends plus de nouveaux patients ». Cette phrase, de nombreuses personnes, en quête d’un médecin traitant, l’ont entendue. Puisque 3,8 millions de Français (soit 5,7 % de la population) vivent, en 2018, dans une zone sous dotée en médecins généralistes contre 2,5 millions (3,8 % de la population) en 2015, selon une étude de la Drees. La Guyane, la Martinique sont les régions les plus touchées, suivies par l’Ile-de-France et le centre Val-de-Loire. Comment l’explique-t-on ? Par des départs à la retraite notamment et par l’augmentation des besoins de soins de la population française. Cette étude précise que « les territoires les mieux dotés en médecins généralistes sont aussi les plus attractifs tant du point de vue de la croissance démographique que des équipements (sportifs, culturels, commerciaux et scolaires) ». Ce que confirme le Dr Jacques Morali, délégué général aux relations internes au conseil national de l’Ordre des médecins : « Les déserts médicaux sont souvent des déserts tout courts. Il faut rompre la fracture numérique de certains territoires. Il n’y a rien de plus terrible que de ne pas pouvoir faire de téléconsultation parce que la fibre n’est pas installée. Même si on note également qu’il existe des déserts médicaux, dans des villes comme Paris ».
En 2016, l’Ordre des médecins a créé un observatoire des initiatives menées sur le territoire. « L’objectif est de faire savoir que, malgré les difficultés en matière d’accès aux soins, des solutions nées du terrain apportent des réponses concrètes et efficaces dans les territoires de proximité. L’Ordre veut ainsi soutenir les énergies à l’œuvre dans les zones en tension », précise le Dr Jacques Morali.
S’il n’existe pas de solution miracle pour attirer les jeunes médecins, quelques pistes se dessinent. Une étude de l’Irdes, publiée en mars 2020, met par exemple en avant l’attractivité des maisons de santé pour les jeunes médecins généralistes de moins de 40 ou 45 ans.
A lire aussi : Les jeunes médecins attirés par les maisons de santé
Des initiatives ont vu le jour pour inciter bien en amont les jeunes à choisir le métier de médecin. Ainsi en 2018, dans le Val de Loire, le dispositif « Ambition PACES » a été mis en place dans plusieurs lycées par l’ARS (Agence régionale de santé), la faculté de médecine de Tours et la région Centre-Val-de-Loire. Objectif : proposer une initiation aux études de santé aux élèves de Terminale.
Pour Jacques Morali, « la formation en elle-même a besoin d’un relookage, comme le système de santé d’ailleurs. Il faut repenser l’exercice et faire que le monde hospitalier et le monde libéral travaillent ensemble afin d’éviter la rupture dans la prise en charge du patient »
Le cadre de vie est aussi un critère de choix important avec le dynamisme économique et culturel du territoire, la facilité à trouver un travail pour le conjoint, la présence d’établissements scolaires à proximité tout comme le cadre d’exercice. « L’organisation du travail est un critère, les jeunes médecins ne veulent plus travailler seuls mais en groupe, d’où les maisons médicales pluriprofessionnelles (infirmiers, kinés…). Ils préfèrent parfois un poste salarié avec des horaires, un cadre de travail et une sécurité. Et un autre phénomène est en train de se créer : les conséquences de la Covid-19. Ces deux mois de confinement ont mis à bas la médecine générale. Les médecins se sont retrouvés sans travail. Les jeunes l’ont vécu et hésiteront à s’installer. Donc si on veut améliorer la couverture territoriale, il faut rendre attractif le métier et le territoire. Il ne faut pas mettre des pansements sur des plaies mais bien traiter le mal en profondeur », conclut Jacque Morali.
Commentaires