Maladies et traitements
Qu’est-ce que le trouble dysphorique prémenstruel (TDPM) ?

Publié le
Par Angélique Pineau
Temps de lecture estimé 6 minute(s)
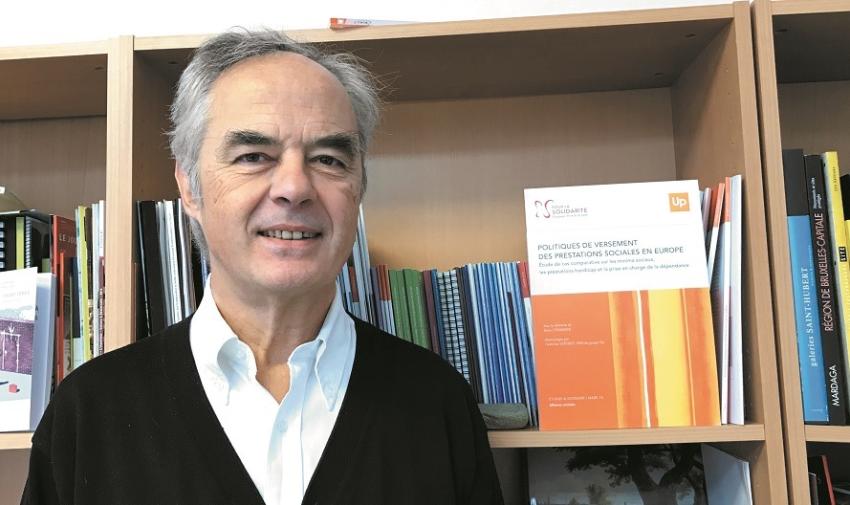
Économiste belge, Denis Stokkink est le président-fondateur du think tank européen Pour la solidarité. Il est également membre du GECES, le groupe d’experts de l’économie sociale et de l’entrepreneuriat social de la Commission européenne. Il en a d’ailleurs été le rapporteur général en 2015 et 2016.
C’est un modèle économique qui repose sur une organisation démocratique de l’entreprise et dont les surplus financiers sont limités et répartis socialement parmi leurs membres ou reversés à des fins sociétales. L’économie sociale est porteuse d’une réalité économique, ancrée dans les territoires, au travers de mutuelles, de coopératives, d’associations… Mais elle est aussi fondée sur des valeurs, en particulier l’égalité et la solidarité. Et ce sont ces valeurs qui différencient l’économie sociale de l’économie capitaliste, dominante en Europe. L’égalité et la solidarité sont également les valeurs fondatrices du modèle social européen.
Les définitions sont multiples et les mots diffèrent selon les pays. En France, on parle d’« économie sociale et solidaire » et le plus souvent, ailleurs en Europe, d’« économie sociale ». Certains pays s’accrochent à une terminologie ou à des statuts spécifiques. Mais finalement, tout cela est assez accessoire. Ce qui compte, c’est qu’il existe bel et bien un mouvement économique dans l’ensemble des pays européens, qui partage les mêmes valeurs et le même type d’organisation. Essayons de voir ce qui nous rapproche plutôt que ce qui nous divise.
Elle représente une part importante de l’économie européenne : environ 10 % du PNB (le produit national brut), c’est-à-dire de la richesse produite en Europe, et près de 7 % de l’emploi. Ce qui est plus important que la sidérurgie, l’agriculture ou le secteur automobile. Pourtant, elle est moins mise en évidence. Et donc assez peu connue du grand public.
Il y a toutefois des différences entre les pays européens. Dans les pays d’Europe centrale notamment, l’économie sociale ne représente parfois que 1 ou 2 % de l’emploi (en France ou en Belgique, c’est plutôt autour de 10 à 12 %). Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas un mouvement dans ces pays. Bien au contraire. Ces cinq dernières années, certains ont vraiment mis l’accent sur l’économie sociale. Je pense par exemple à la Slovénie ou à la Slovaquie.
Je dirais que les torts sont partagés. Mais la bonne nouvelle, c’est qu’il y a des tas de progrès à faire. Il y a d’abord une responsabilité interne aux acteurs. On peut se demander pourquoi certains d’entre eux ne mettent pas plus en valeur l’économie sociale. De même, certains pays font des efforts pour la développer, d’autres moins. La France, un pays qui se veut moteur dans ce domaine, n’a plus de ministre de l’économie sociale et solidaire, ce qui n’était plus arrivé depuis très longtemps. Certes, vous avez un Haut-commissaire, mais ce n’est pas la même chose.
En revanche, je pense qu’au niveau de la Commission européenne, il y a eu toute une série d’initiatives visant à rendre plus visible l’économie sociale en Europe depuis 2011. Elle a notamment créé un groupe d’experts (le GECES), qui représente à la fois tous les États et les acteurs eux-mêmes et qui peut faire des recommandations. Cela pourrait aller encore plus vite bien sûr, mais ça avance.
Tout à fait. D’ailleurs, en novembre 2017, le socle européen des droits sociaux a été adopté, à la fois par la Commission européenne, par le Parlement européen et par le Conseil européen donc par l’ensemble des États. Il établit la liste des vingt principes clés formant le modèle social européen. On y trouve par exemple : l’égalité entre les femmes et les hommes, la protection sociale, les soins de santé, l’inclusion des personnes handicapées, le logement et l’aide aux sans-abri… Et il faut rappeler qu’en matière de droits sociaux, l’Europe est la seule région du monde – une région qui compte quand même 500 millions d’habitants – à avoir un socle de droits sociaux aussi fort. Et beaucoup de valeurs présentes dans ce socle sont partagées par les acteurs de l’économie sociale.
Partiellement seulement. D’ailleurs, il y a une contradiction entre ce socle et les droits que nous avons réellement en tant que citoyennes et citoyens européens. L’égalité, valeur fondatrice de l’Europe et fondatrice de l’économie sociale, n’est plus au cœur de la réalité économique européenne. Les inégalités augmentent depuis une vingtaine d’années. Concrètement, cela veut dire que les plus riches deviennent proportionnellement encore plus riches et les plus pauvres encore plus pauvres.
Cette contradiction, c’est ce que j’appelle le syndrome du flamand rose : cet oiseau qui a deux pattes mais qui ne repose que sur une seule. Les deux pattes sont le développement économique et la justice sociale. Les deux étaient sur le sol au moment de la création de l’Europe. Mais depuis un certain nombre d’années, les États nationaux ont fait relever la patte de la justice sociale. Avec le temps, les valeurs d’égalité ont été transformées en inégalités et de solidarité en compétitivité.
C’est ce qui explique en partie les mouvements de contestation citoyens auxquels nous assistons aujourd’hui, comme les gilets jaunes en France. Mais c’est ce qui explique aussi l’attrait important vers l’économie sociale. De plus en plus de jeunes veulent avoir plus de sens dans leur travail. Ils se tournent par conséquent vers cette économie, porteuse d’égalité, de solidarité et de justice sociale.
Think tank européen indépendant, Pour la solidarité est « engagé en faveur d'une Europe solidaire et durable ». En plus de l’économie sociale, ce laboratoire d’idées et d’actions travaille sur d’autres thématiques : les affaires sociales, le développement durable, la participation citoyenne, la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et la diversité. Pour la solidarité est à l’origine de l’Observatoire européen de l’économie sociale.
Initiatives solidaires

Initiatives solidaires

Initiatives solidaires

Commentaires