Maladies et traitements
Qu’est-ce que le trouble dysphorique prémenstruel (TDPM) ?

Publié le
Par Pauline Hervé
Temps de lecture estimé 5 minute(s)


Béatrice Gurrey : Ces signes n’étaient pas si bénins, a posteriori. Ils m’ont paru suffisamment inquiétants pour que je contacte leur médecin traitant, afin qu’il leur prescrive les examens appropriés pour voir s’il y avait, ou non, une maladie neurologique. Je ne suis pas médecin mais mes parents m’ont paru assez perdus pour que je m’inquiète de la situation. Ma mère ne parvenait pas à rentrer chez elle après avoir rendu visite à une amie, alors qu’elle connaissait ce court chemin par cœur depuis plus de soixante ans. Mon père avait des accès d’agressivité voire de violence. Il avait détruit sans même en avoir conscience un petit jardin qu’il avait mis des années à faire pousser, en le bêchant comme un forcené. Je lui montrais comment utiliser son smartphone et j’avais la certitude qu’il ne comprenait absolument rien de ce que je lui disais : c’était anormal.
Ils semblaient continuer à vivre la vie qu’ils avaient toujours vécue, mais les courses, la cuisine, le marché, toutes ces activités banales devenaient insurmontables ou bien ils les oubliaient. Ils avaient même perdu pas mal de poids.
Nous avons décidé, avec mon frère et ma sœur, qu’ils devaient passer des examens : ce ne fut pas une décision facile. D’abord, le généraliste leur a prescrit une consultation mémoire, dans un service de gériatrie, en hôpital de jour. Nous n’avons pas eu les résultats de ce test qui était suffisamment inquiétant pour que la gériatre veuille s’assurer de son diagnostic, notamment par une IRM. L’imagerie radio médicale permet de détecter des lésions précises qui montrent une maladie dégénérative du cerveau. Nous, leurs enfants, habitions à 800 km de chez eux. C’est très difficile de suivre les choses à distance : mes parents ont annulé le rendez-vous sans que nous le sachions.
B.G. : Le plus dur à vivre avec la maladie d’Alzheimer, c’est que quand vos parents perdent la mémoire, vous perdez votre propre identité, ce qui vous a fondé, construit. Vous êtes vous-même un peu perdu. Détecter la maltraitance et la combattre à l’Ehpad, c’est différent, vous êtes dans l’action. Vous avez du chagrin mais ce n’est pas cela qui domine, la priorité c’est de veiller à ce que vos parents soient bien traités.
L’inversion du rôle parent-enfant ne se vit pas de la même façon selon la personne que vous avez en face de vous. Pour mon père, aujourd’hui décédé, ce fut quelque chose d’assez difficile, qu’il n’acceptait pas, même s’il se rendait compte qu’il ne pouvait plus accomplir seul des tâches de la vie courante. Avec ma mère qui donne beaucoup d’amour, d’affection, le fait de devoir s’occuper d’elle comme une personne dépendante est moins complexe. Elle vit aujourd’hui toujours en Ehpad. Le renversement des rôles n’est pas franc : à un enfant, vous apprenez l’autonomie. Avec Alzheimer, les apprentissages sont impossibles, la mémoire flanche, vous ne pouvez rien construire… sinon une nouvelle relation fondée sur beaucoup d’amour, de rire et de gaîté.
B.G. : Oui, ils ont de l’humour et de la poésie. Cela est dû, j’imagine, à une espèce de déstructuration du langage qui produit un petit « choc poétique ». Cela déclenche aussi chez celui qui les entend l’envie de protéger cette personne, et de l’aimer encore plus finalement. D’abord parce qu’elle vous donne du rire, et après toute cette tristesse c’est précieux !
Je me souviens de mon père disant : « Des gens sont passés au large de notre île ». Je comprenais qu’il se sentait enfermé, isolé et qu’il en a énormément souffert. Il pouvait être violent, mais aussi s’exprimer de façon très délicate et sensible. Beaucoup de personnes qui m’ont écrit m’en parlent. La gériatre qui a suivi mes parents m’a dit : « Le langage des patients atteints de cette maladie est parfois extrêmement beau ».
Je crois beaucoup à tout ce qui est sensible, l’art, la musique, la peinture, tout ce que l’on peut apporter comme nourriture culturelle à un malade. Quand ma mère écoute des musiques qu’elle aime, elle a l’air incroyablement heureuse – davantage que lorsqu’on lui met une chaîne de téléachat en continu !
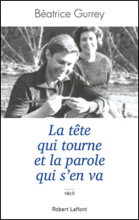
B.G. : Ils se sentent réconfortés par ce livre. En réalité, nous nous apportons un réconfort mutuel. La similitude de certaines situations entre mon histoire et la leur est parfois telle que c’en est troublant ! Mais loin de les replonger dans la tristesse, cela soulage les lecteurs de voir qu’une autre famille a vécu ce parcours avec ses peines et sa manière de combattre ce grand oubli. Tout simplement, cela aide de se sentir moins seul.
*Béatrice Gurrey, « La tête qui tourne et la parole qui s’en va », ed. Robert Laffont, 2018.
Maladies et traitements

Maladies et traitements

Droits et démarches

Commentaires